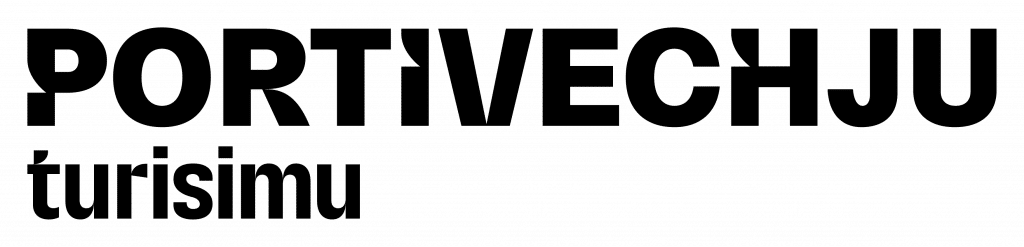serra
liège
Une histoire de père en fils
L’histoire de la famille Serra incarne la passion et la transmission du métier de liégeur à Portivechju, ancrée depuis plusieurs générations. Entre traditions et défis perpétuels, le liège demeure un pilier économique et culturel en Corse. Le petit dernier de l’aventure familiale, Valère illustre l’engagement familial indéfectible, porté par un savoir-faire unique.
Si je meurs dans mon lit, vous pouvez pleurer à mon enterrement, si je meurs au liège en travaillant, je vous l’interdis
André Victor Serra, scurzinu
DATES CLÉS
1880
Toussaint Castelli, premier liégeur de la famille
2012
Naissance de Serra Liège
2020
Valère Serra rejoint l’aventure familiale
2022
Naissance de la boutique Serra Liège à Ajaccio
2023
Création du Syndicat des Subériculteurs Corses
Le poumon économique de Portivechju
Evoquer l’histoire du liège à Portivechju, c’est raconter celle d’un peuple frappé par la misère et qui voit dans ses suberaies l’espoir d’une vie meilleure.
L’usage du liège remonte à l’Antiquité, mais c’est véritablement au Moyen Age que ses vertus sont exploitées de manière pérenne. L’usage du verre se développe et la légende dit que le moine Dom Pérignon, au XVIIème siècle, aurait utilisé des bouchons de liège pour les bouteilles de champagne. L’industrialisation de la verrerie embarquera avec elle l’exploitation du liège.
C’est dans ce contexte que débarquent en Corse, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, des entrepreneurs varois, puis catalans, venus exploiter les nombreuses suberaies de la région. S’offre alors une véritable perspective économique aux propriétaires de ces forêts.
Se construit, en 1858 à la Marine, sous l’impulsion de la société Delabre & Cie, l’usine de transformation Saint Michel, du nom de la petite église voisine. Sa production est récompensée d’une médaille d’or à l’exposition Universelle de Paris en 1867. Les Catalans fonderont, eux, en 1876 l’usine St Joseph du nom du quartier de San’Ghjasepppu. Ce n’est qu’en 1938 que la famille Alessandri reprendra l’usine.
La récolte du liège et la construction des usines à Liège arrivent comme une bouffée d’oxygène pour une population qui a faim dans un territoire qui est rude. Il n’y a pas une famille porto-vecchiaise qui n’ait pas un membre travaillant dans le liège. Si les Varois et les Catalans forment les Corses à la récolte du liège, son implantation est d’une telle envergure, que ce savoir-faire de scurzinu, de liégeur, devient “endémique” et se transmet de père en fils.
C’est ainsi que Toussaint Castelli, arrière-arrière-arrière-grand-père de Valère Serra, s’embarque en 1880 dans l’aventure du liège, et ouvre la voie à sept générations de scurzini.
Si Toussaint se forme à la subériculture, son fils André pousse ses prétentions plus loin et se forme au métier de contremaître, créant alors sa propre exploitation de liège. Il prendra sous son aile le jeune époux de sa fille Rose, Simon Serra, et lui transmettra son savoir-faire de récolteur et la passion qui va avec.
Un savoir-faire passion
A l’origine, cette transmission n’est pas patrimoniale mais vitale. Le grand-père de Valère, André Victor, malgré son appétence pour les mathématiques, est retiré de l’école pour seconder son père Simon à l’âge de 9 ans. Force de la nature de la fratrie, André Victor n’a d’autre choix que de devenir scurzinu pour nourrir ses sept frères et sœurs !
Mais très tôt, le travail du liège devient un métier passion, qui se transmet comme un virus. André Victor créé sa propre exploitation à l’âge de 14 ans, ouvre son dépôt aux Quatre Chemins, puis à Murateddu, et récolte toutes les saisons jusqu’à sa dernière heure, à 82 ans.
Ses fils André et Simon touchent au liège dès l’âge de 6 ans. Leur père leur promet un pain au chocolat contre le ramassage de tous les petits morceaux de liège. Valère enfant accompagne également son père et son grand-père sur les exploitations, tout comme aujourd’hui il se promène dans les suberaies avec sa fille de 9 ans, Elisabeth, qui sait distinguer le catarcionu, le premier liège, du liège de bonne qualité.
Ce “virus passion” touche la famille Serra de manière différente. Simon, dès la fin de ses études dans les années 1980, rejoint son père sur l’exploitation et part travailler jusque dans la Cap Corse. Mais d’autres sphères l’attirent, comme l’enseignement, et se décide à quitter l’exploitation. Son frère, André Léopold, reprendra l’exploitation au décès d’André Victor, lâchant son poste de professeur à Aiacciu, refusant de laisser s’éteindre l’entreprise et de laisser ses ouvriers démunis. Petit clin d’œil aussi à André Victor qui disait de ses fils qu’« ils avaient mal tourné » en choisissant la voie de l’enseignement plutôt que le travail du liège. »
Le père de Valère ajoute une dimension créatrice à l’exploitation. Ainsi, naissent des corbeilles de fruit, a buzzichedda, des crèches, des lampes, des avions, etc. : l’enseigne « Serra Liège » est née.
De son côté Valère, porté par sa passion pour les sciences, poursuit des études de math sup sur le continent et devient ingénieur modélisateur à Saint Gobin. En 2017, papa d’une petite fille, Valère se décide à revenir en Corse. De la même manière qu’il faisait des saisons avec son grand-père lorsqu’il était étudiant, le jeune homme seconde son père durant la saison de récolte.
A l’âge de 35 ans, Valère réalise que son premier amour est le liège. Il saute le pas, rejoint véritablement l’exploitation familiale et ouvre, deux ans plus tard, une boutique à Ajaccio. Touchés par les créations d’André, de nombreux créateurs se penchent alors sur ce matériau et viennent avec leurs regards et leurs travails s’exposer dans le show-room ajaccien, qui se décline alors dans la mode, les bijoux, la papeterie, l’art de la table…. C’est ainsi 30% de l’exploitation Serra qui est dédié à l’artisanat. Le reste, comme pour la dizaine de liégeurs corses, part vers des usines de transformation en Sardaigne ou au Portugal, le liège de qualité servant aux bouchons, le reste à la granulation, notamment pour l’isolation thermique… et même les fusées, où le liège est utilisé comme bouclier thermique.
La Fragilité de la filière
Le liège a connu son âge d’or jusqu’aux années 1970, à travers la production de bouchons et de matériaux isolants. Ses propriétés naturelles, perméable au gaz et imperméable au liquide, en font un matériau prisé, intéressant les investisseurs de toutes parts..
Mais la filière affronte différentes crises. Dès le début du XXème siècle, l’essor de la pétrochimie, offrant de nouvelles propositions d’isolation, donne un premier coup à la production du liège.
Elle se recentre alors sur les bouchons. Suivent dans les années 1960, la concurrence ibérique et, dix ans plus tard, la « crise du bouchon » avec l’apparition du plastique. La qualité est nettement moindre, mais le coût aussi. Les usines corses ferment les unes après les autres, la dernière étant celle des frères Poggi à Cauro dans les années 1980.
Dans les années 2000, le champignon TCA rend les bouchons responsables des « bouchonnages » des vins et mène à la troisième crise. Aujourd’hui, le TCA est détectable, mais le mal financier est fait. Il ne reste actuellement, en France, que quatre unités d’industrie : Lièges HPK, Au Liégeur, Prima Liège et Liège Expansé.
Valère garde foi en la valeur de ce matériau naturel et sain, tout comme son grand-père qui a livré les frères Poggi jusqu’à ce que la porte de l’usine soit close, même lorsqu’ils n’étaient plus en mesure de le rémunérer. Ce n’était pas une confiance aveugle, il s’agissait d’une entreprise qui avait pris le virage high tech, qui exportait dans toute l’Europe, et André Victor était convaincu que l’usine allait se redresser. Peut-être n’avait-il pas tort, mais le décès d’un des deux frères sonne le glas de l’entreprise.
Cette ténacité et cette confiance en la filière, André Victor l’a transmise à ses fils et petit-fils. Malgré les nombreuses fermetures, la famille Serra a continué d’avancer en faisant le dos rond, en réduisant les coûts, en limitant l’appel à l’aide extérieur, etc. Le savoir-faire est là et l’expérience familiale fait qu’ils savent que les crises sont temporaires.
Comme d’autres familles de liégeurs, les Tafani, à l’image d’Antoine, qui est le dernier trieur qualifié de Corse ou les Milanini avec Jean-Baptiste qui a été formé avec le grand-père de Valère, ils ont su traverser les tempêtes.

La Préservation de la filière
Aujourd’hui, la suberaie recouvre en Corse environ 30 000 hectares, superficie un peu moins étendue qu’hier du fait, entre autres, de la bétonisation et du chêne vert qui s’impose… Mais rien de dramatique, contrairement à l’échelle nationale, où la suberaie a été divisée par deux alors que la forêt a été multipliée par deux, faute de démasclage et de la disparition du métier de liégeur.
La Corse a été épargnée car les scurzini sont là. Mais il y a une réalité de suberaie vieillissante et, sans retour à un véritable travail de liégeur, c’est-à-dire démascler le liège mâle, retirer le liège brûlé, préparer et traiter la suberaie, etc., la suberaie périclitera.
C’est dans cette perspective qu’André et Valère ont initié, en 2023, la création du Syndicat des Subériculteurs Corses car, au-delà de quelques divergences, l’ensemble des liégeurs regardaient dans la même direction.
Cette union se veut construire quelque chose de durable, et cela appuyé par le Pouvoir Public pour encadrer la protection, la régénération et le développement de la suberaie, comme cela se fait au Portugal. La protection de la filière est aussi un des enjeux du Syndicat : il a demandé à entrer au Conseil d’administration de l’ODARC, a obtenu des pouvoirs publics que les suberaies publiques soient uniquement exploiter par les liégeurs corses, a réorienté les subventions de l’ODARC aidant les liégeurs dans la remise en état de leur suberaie.
C’est dans cette même démarche que Valère veut porter le projet d’une usine de transformation en Corse. Pourquoi envoyer du liège au Portugal pour qu’il soit transformé, alors qu’il est possible de le faire sur place, ne serait-ce le granulat ? Et cela, au risque de ramener des maladies non présentes en Corse comme u varmu, le ver du liège proliférant en Sardaigne et dans le Var. Si demain l’usine est créée, le monde du liège, dans son ensemble, va en bénéficier, des propriétaires forestiers à l’industriel en passant par les liégeurs, créant une véritable valeur ajoutée à la Corse.
Valère ne se pose pas en garant d’une transmission familiale figée, mais assume pleinement l’héritage d’une passion qu’il veut voir perdurer. Ce savoir-faire, il l’a partagé avec Mickael, un jeune que Valère a formé, qui travaille aujourd’hui à ses côtés, et à qui, sans doute, il a transmis son virus…